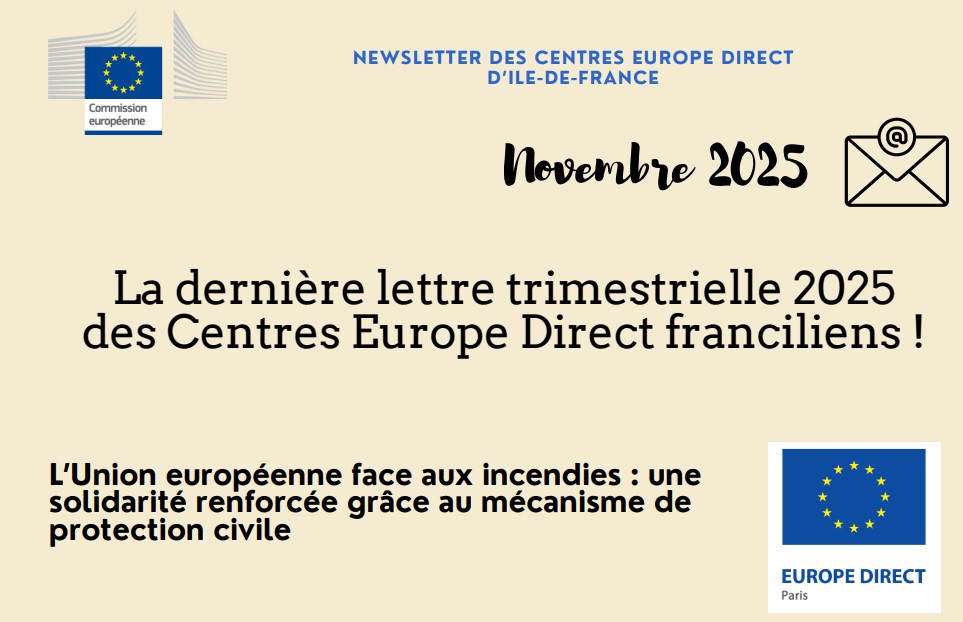Le 8 mars 2024 a été un jour historique pour la France ! La liberté d’avorter a été inscrite dans la Constitution française dans ces termes : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. », faisant ainsi de la France le premier pays du monde à constitutionnaliser ce droit ! Ce projet a été porté par de plusieurs femmes députées, notamment par Mélanie Vogel (ancienne collaboratrice de la Maison de l’Europe), qui est l’une des premières élues (députée Europe écologie Les Verts : EELV) à avoir milité en faveur de cette inscription. Cette question a été soulevée en réaction à la décision d’annulation du 24 juin 2022 d’une décision majeure de la Cour Suprême américaine de 1973, Roe versus Wade, qui consacrait le droit à l’avortement au niveau fédéral. C’est une victoire idéologique, morale, qui récompense des années de lutte pour la libéralisation du corps de la femme, pour les droits des femmes tels que le droit de disposer de leurs corps, le droit à la vie privée, le droit à la santé, le droit de disposer d’une vie privée et familiale.
Néanmoins, cette victoire est à relativiser, car on parle d’inscription d’une « liberté » à recourir à l’avortement et non d’un « droit », cela est le fruit d’un consensus puisque le président souhaitait inscrire un droit. Mais quelle est la différence ? La notion de droit engage l’État à tout mettre en œuvre pour qu’une femme puisse avorter et en faisant un droit fondamental. Or, ici cette notion de droit n’est pas présente, ce qui signifie que demain un prochain gouvernement pourrait restreindre sans modifier la constitution l’accès à l’avortement. Par exemple, en abaissant le délai maximal pour y recourir. Tandis que la notion de liberté fondamentale est une capacité de faire, une action possible sans contrainte. La liberté n’est pas opposable à l’État, il devra poser quelques garanties mais ne se verra jamais mis en cause. Aujourd’hui il existe en effet la loi Veil, qui permet de garantir ce droit, mais elle peut être facilement abrogée par un Parlement dont la couleur politique est contraire à ces principes (comme le Rassemblement national, par exemple). Dès lors, beaucoup d’organisations féministes soutiennent que cette « liberté garantie » est certes inscrite dans la Constitution mais que l’État ne sera pas garant de sa mise en œuvre opérationnelle. Il devra seulement s’assurer que les tiers n’empêchent pas d’avorter.
Qu’est-ce que c’est en fait l’IVG et qu’en est -il de l’histoire de ce combat ?
L’Interruption volontaire de grossesse (IVG) est une technique médicale permettant de mettre fin à une grossesse sans donner naissance à un enfant et utilisée pour une raison personnelle (par opposition à l’avortement thérapeutique qui intervient pour une cause médicale). L’interruption volontaire de grossesse est strictement encadrée par la loi. En effet, cette thématique a toujours suscité nombre de débats car elle est corrélée à des questions éthiques, de santé, de vie privée, d’autonomisation et d’indépendance de la femme. Le droit de disposer corps de son corps pour les femmes n’a pas toujours été reconnu.
Avant le début du XXe siècle et les nombreux combats qui ont façonné cette ère, la contraception n’existait pas ou cela relevait de pratiques coutumières tabous et parfois même clandestines. L’avortement était alors extrêmement mal perçu dans la société jusqu’à être sanctionné comme un crime. Le féminisme de la « première vague » avait eu lieu sous la IIIe République et était centré sur la revendication du suffrage féminin. Puis, au XXe siècle, le féminisme dit de « deuxième vague » apparait avec la volonté de protéger le droit des femmes en parallèle de la montée en puissance des droits sociaux. Et de nombreux combats se dessinent à l’image de celui du droit des femmes et du droit de disposer de leur corps. Cela passe par de faibles avancées, en France depuis 1923, l’avortement n’est plus considéré comme un crime, mais il reste un délit puni par article 317 du code pénal. En 1967, une première brèche a été ouverte avec l’adoption de la loi Neuwirth libéralisant la contraception en France. Cette loi est perçue comme un barrage à l’avortement et non comme une avancée du droit des femmes. Mais finalement, bien loin d’éradiquer l’avortement, la libéralisation de la contraception fait au contraire passer au premier plan la question de la légalisation de l’interruption de grossesse, dont va s’emparer le Mouvement de libération des femmes (MLF).
Le combat pour la légalisation de l’IVG est un combat mené par des milliers de femmes et d’hommes qui luttent pour permettre aux femmes de choisir leur vie. En France, ce combat est mené par des femmes dans le milieu du droit pour faire avancer les législations. L’avocate Gisèle Halimi est connue, par exemple, pour le Procès de Bobigny, cas dans lequel elle a défendu une jeune fille mineure condamnée pour avoir eu recours à l’IVG alors qu’elle était tombée enceinte à la suite d’un viol. Elle a défendu également les médecins et la mère de la jeune fille, qui l’ont aidée. Elle a démontré au cours du procès le caractère obsolète de l’article 317 du code pénal de 1810, qui condamne l’avortement, et de la loi du 31 juillet 1920, réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle, poussant ainsi les pouvoirs publics à changer la loi.
En parallèle, Simone Veil s’est battue également pour faire abolir le délit et pour faire reconnaître ce droit. Et en le 17 janvier 1975, la loi Veil est adoptée et légalise enfin le droit à l’IVG. Le délit d’entrave à l’IVG a quant à lui a été définitivement adopté par le Parlement le 15 février 2017 : ce texte de loi s’attaque aux sites de “désinformation” sur l’IVG, qui agissent dans le but de dissuader ou d’induire intentionnellement en erreur les femmes qui souhaitent s’informer sur l’avortement. D’autre part, le Parlement français a définitivement approuvé le 23 février 2022 l’extension à quatorze semaines de grossesse pour l’avortement, allongeant le délai de l’IVG qui était auparavant fixé à 12 semaines.
L’adoption de cette loi est certes une victoire historique mais le combat est perpétuel car il est sans cesse remis en question selon les options politiques des gouvernements et ce dans tous les pays du monde. Certains pays voient cet acte comme un crime qui porte atteinte au droit à la vie de l’embryon or le droit à la vie est un des droits les plus protégés au monde. La chaine CNEWS a même récemment relayé une information de la cheffe de file des députés LFI, Mathilde Panot (publiée sur X), dans l’émission « En quête d’esprit », présentant l’IVG comme « la première cause de mortalité dans le monde » (78 millions de « décès »)… Cependant, ce droit est menacé chaque jour dans le monde et même dans les pays les plus démocratiques et protecteurs des droits humains. C’est pourquoi l’inscription de l’IVG dans la Constitution française est une avance majeure et historique dans la lutte pour les droits des femmes.
Cette victoire historique montre tout de même les limites et les dangers auxquels doit faire face ce droit indispensable pour les femmes. Mais qu’en est-il aujourd’hui de la protection de ce droit à l’échelle de l’UE ?
Aujourd’hui, tous les pays de l’Union européenne (UE) autorisent l’interruption volontaire de grossesse (IVG), Malte étant le dernier à rentrer dans les rangs (juin 2023). Cependant, il existe de grosses disparités d’accès à l’IVG d’un État à l’autre. Le délai maximal pour y avoir recours varie de 10 semaines à 24 semaines. Même les pays les plus conservateurs en la matière ont évolué, en Irlande, par exemple, le recours à l’IVG pouvait être passible de 14 ans d’emprisonnement. Aujourd’hui, cet État l’admet jusqu’à 24 semaines dans les cas de “risque pour la vie” ou de “grave danger pour la santé” de la femme enceinte.
Cependant, dans certains États l’avortement est encore limité. En Pologne par exemple l’avortement n’est autorisé qu’en de cas de viol ou de danger pour la vie de la mère, depuis janvier 2021. Après avoir tenté de l’interdire totalement en 2016, le gouvernement l’a restreint en supprimant la possibilité d’avorter en cas de malformation grave du fœtus, ce qui concernait plus de 90 % des IVG dans le pays. Ce droit reste donc fragile aussi bien dans les États conservateurs que démocratiques.
L’IVG reste donc fortement limitée en pratique dans certains États membres de l’UE. Les médecins peuvent effectivement faire appel à la « clause de conscience » les autorisant ainsi à ne pas pratiquer l’IVG si cela heurte leurs convictions éthiques, morales ou religieuses. Dans l’UE, cette classe est prévu au sein de 23 pays (dont la France), et seules la Suède, la Finlande et la Lituanie ne l’autorisent pas. En 2020, cette clause a été utilisée en moyenne à hauteur de 10% en Europe.
Dès lors, la France en inscrivant cette liberté dans sa Constitution devient, comme ci-dessus, le 1er pays au monde à protéger au niveau constitutionnel l’IVG. Le président Emmanuel Macron veut même porter ce projet à l’échelle européenne en inscrivant l’IVG dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE. La prochaine étape est de faire rayonner les valeurs de l’UE en protégeant ce droit grâce à son inscription dans la Charte lui donnant une valeur de droit primaire ce qui signifie qu’il primerait sur les considérations nationales.