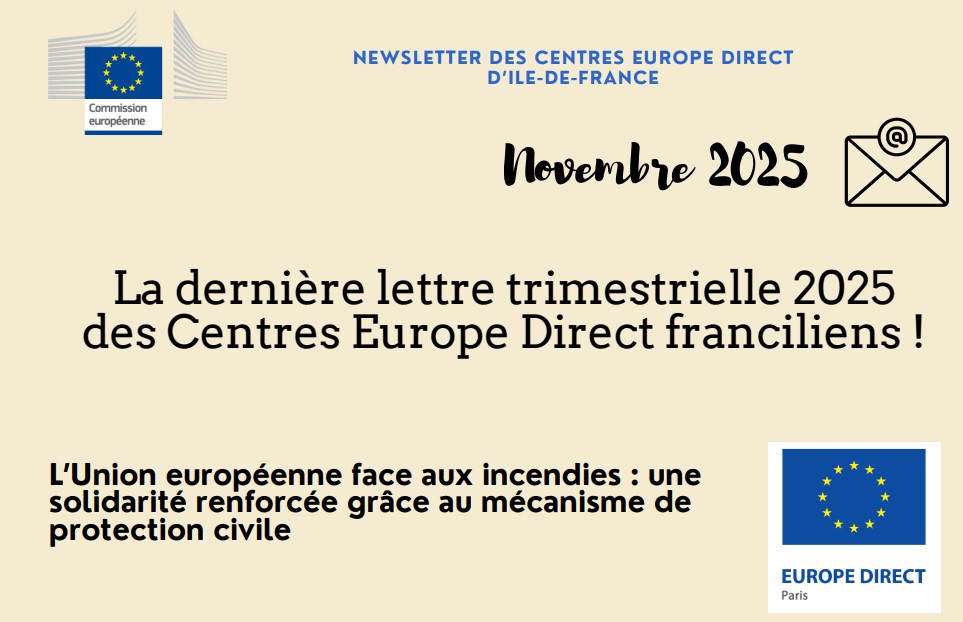« La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent »
Déclaration Robert Schuman 9 mai 1950
A la fin de la Seconde Guerre Mondiale, un climat géopolitique incertain règne entre les grandes puissances, sorties gagnantes de la guerre. L’Allemagne de l’Ouest, les Etats-Unis, la France et le Royaume Uni sont pris dans un engrenage politique face à l’avenir allemand et son statut, craignant que Berlin ne redevienne une menace pour la France.
Le bloc soviétique devient alors un obstacle de taille et la nécessité de s’allier pour le contrer devient indispensable. Les démocraties libérales d’Europe de l’Ouest ne peuvent se permettre de se déchirer et de s’entretuer alors qu’à l’Est du « Rideau de fer » démocraties populaires sont mises dans un seul et même mouvement, au service de la puissance du bloc soviétique. Commence alors une longue période de négociation et de compromis dans la formation d’une seule et même unité de défense, ayant pour finalité l’écriture de la Déclaration du 9 mai 1950 par Robert Schuman .
Qui est Robert Schuman ? Né en 1886, au Luxembourg, de nationalité allemande, il obtiendra la nationalité française après la Seconde Guerre Mondiale. Il s’investira toute sa vie en faveur du renforcement de la coopération et la prospérité des peuples, rappelons seulement son intervention dans la mise en place du Conseil de l’Europe, à Strasbourg, en 1949. En 1950, il occupe le poste de Ministre français des Affaires étrangères. Il sera aidé dans l’élaboration du plan par Jean Monnet, haut fonctionnaire français et Commissaire général au Plan à l’époque. Ce dernier vient d’une famille de producteurs de Cognac et est considéré comme un des « pères fondateurs » des Communautés européennes. Il fut aussi le personnage central de cette déclaration, puisque ce fut lui qui conseilla Schuman !
Dès le mois d’avril 1950, Jean Monnet eut l’idée de mettre fin aux souverainetés nationales, sans pour autant l’expliquer. Il développa son idée sur la base d’une « première étape à la fédération européenne » tout en assurant une coopération via des partenariats avec les pays européens. Ayant besoin d’un appui politique fiable et honorable, il fit appel à Robert Schuman afin de faire de ce traité un acte à la consonance juridique et gouvernementale.
Ensemble, ils vont œuvrer en faveur d’une logique commune : « la Paix ». Pour formuler cet idéal, les deux hommes vont proposer un plan dans lequel la mise en commun de certaines ressources, principalement le charbon et l’acier, va être le point d’accroche de l’héritage européen que nous connaissons aujourd’hui. L’idée est donc de dissiper toute forme de conflit significatif à celui de la Seconde Guerre Mondiale et d’en tirer le même bilan : pour cela, l’Allemagne et la France vont mettre en commun la production de charbon et d’acier, ce qui aboutira à la création en 1951 de la CECA : la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier.
La CECA, dont les membres fondateurs sont la France, l’Allemagne de l’Ouest, l’Italie, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique, représente alors la première institution supranationale qui formera l’Union Européenne actuelle.
Vers un plan pour l’avenir de l’Europe
Plus qu’un discours, la déclaration Schuman est un plan sur l’avenir. A la fois économique par le réajustement des prix, son projet d’investissement, de rationalisation de la production et la fusion des marchés pour une meilleure productivité, il scellera le pacte de non-agression entre l’Allemagne et la France et la solidarité entre tous les autres pays adhérents, avec la suppression de tout droit de douane et d’un coût de transport non différentiel.
L’offre de cette production partagée ne sera soumise à aucune discrimination ou aucun rejet et ouvrira la voie à la parité militaire et à la paix sur une base égalitaire.
Cette solidarité universelle entrainera le développement et le rayonnement des régions et des continents les plus reculés au premier rang desquels, se trouve le continent Africain. La division des peuples, par leurs histoires, leurs richesses et leurs poids ne sera plus accordée sous la domination du continent Européen.
Pour Robert Schuman et Jean Monnet, le second pas d’un accord de paix significatif doit absolument passer par la création d’institutions efficaces qui encadrent et contrôlent la production du charbon et de l’acier. En coordonnant les investissements, les prix, en veillant au respect des règles de concurrence et de protection sociale, la gestion en commun du charbon et de l’acier doit dépendre d’une institution financièrement autonome ; la Haute Autorité, capable de fonctionner comme un organe collégial composé de personnalités indépendantes. En agissant dans l’intérêt général, la Haute Autorité renvoie une réponse originale à l’individualisme national.
Par sa déclaration, Robert Schuman veut provoquer un électro choc pour mettre en place le processus d’intégration européenne. Construite et rédigée à l’égard de tous, la déclaration Schuman veut provoquer des réactions afin de frapper l’opinion et pousser les gouvernements à dialoguer.
Le 9 mai 1950 à 18H, le salon de l’Horloge du Quai d’Orsay est transformé en salle de presse dans laquelle Robert Schuman fait l’apologie de son discours. Peu de journalistes sont présents, ni la radio, ni la télévision n’ont fait le déplacement. Ce qui obligera bientôt Schuman à réenregistrer sa déclaration pour que l’Histoire puisse en garder la trace ! Les réactions à la déclaration sont diverses, mais dans l’ensemble, l’opinion publique réagit plutôt favorablement. Sur le plan diplomatique et malgré les difficultés techniques, les pays européens approchés ne souhaitent pas assister à la construction de l’Europe sans apporter leur pierre à l’édifice.

Les enjeux du plan Schuman
Un mois plus tard, les représentants des Six (France, Allemagne, Italie, Benelux) entament à Paris les négociations. Les pays du Benelux réclament la construction d’une instance intergouvernementale ; le Conseil spécial de ministres. Dubitative à l’idée d’une haute autorité, la Grande-Bretagne choisit de rester à l’écart de toute considération à l’égard de la mise en commun des ressources.
Le 18 avril 1951, le traité CECA est signé et scellé à Paris par Robert Schuman pour la France, Konrad Adenauer pour la RFA, Paul van Zeeland et Joseph Meurice pour la Belgique, le comte Carlo Sforza pour l’Italie, Joseph Bech pour le Luxembourg, Dirk Stikker et Jan Van den Brink pour les Pays-Bas.
Strasbourg incarnait déjà la réconciliation franco-allemande, devenant en 1949 le siège du Conseil de l’Europe, une organisation intergouvernementale créée pour promouvoir la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme en Europe. En 1952, la ville accueille également l’Assemblée commune de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), qui évoluera par la suite pour devenir le Parlement européen. Ainsi, Strasbourg s’affirme comme un centre névralgique de la gouvernance européenne, symbolisant l’engagement de l’Europe en faveur de la paix et de la coopération.
Conclu pour une durée de cinquante ans, le traité de la CECA instaure les bases d’une Europe plus forte, plus unie et plus commune à l’instar de ce pourquoi il a été écrit. Quant au 9 mai, il est devenu le jour de l’Europe, sans pour autant être célébré (et férié) comme les autres journées nationales. A ce jour, seul le Luxembourg, pays de naissance de Schuman accorde à ses citoyens un jour férié à chaque 9 mai.